Terrains d'aviation et routes du ciel
en 1930

La France métropolitaine compte 153 aérodromes et bases
d'hydravions au début de l'année 1930.
Ces terrains d'aviation sont alors essentiellement
utilisés par les forces de l'Armée de Terre (l'Armée de l'Air
ne sera officiellement créée qu'en 1933) pour la formation et l'entrainement
des pilotes. Une trentaine d'aérodromes sont dédiés à l'Aéronautique
Marchande (transport de frêt, courrier, passagers...), tandis qu'une
quinzaine de terrains sont réservés à des utilisateurs privés, aéroclubs
ou constructeurs d'avions, tels Potez,
Blériot Aéronautique, Farman,
Morane-Saulnier. Un terrain est réservé
à l'usage de la Compagnie Générale Aéropostale, le célèbre aérodrome de Toulouse-Montaudran, point de départ
de la "Ligne" conduisant à Buenos Aires et Santiago du Chili. Les
terrains les plus importants de l'époque sont les aérodromes de Paris
- Le Bourget (sur lequel Charles Lindbergh s'est posé triomphalement en
1927), Paris - Orly, Marseille-Marignane
et Toulouse-Francazals.
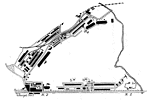
Installations du Bourget,
en 1930
Les
terrains d'aviation de l'époque sont très différents des aéroports et aérodromes
que nous connaissons aujourd'hui, avec leurs pistes d'atterrissage rectilignes
et goudronnées. Les aires d'atterrissage ont alors des formes
très variables, rectangulaires, polygonales
ou circulaires et sont tantôt constituées de terre battue,
tantôt gazonnée. Les terrains sont loin d'être parfaitement plats, et présentent
quelques fois des déclivités en forme de cuvettes. Les pilotes doivent souvent
faire preuve de "vista" au moment de l'atterrissage en prenant garde
aux obstacles parfois parsemés au milieu de la zone d'atterrissage : bosquets,
fossés, trous d'obus...
Le règlement impose
aux pilotes d'effectuer le décollage face au vent, sur la partie
droite du terrain. L'atterrissage doit également être effectué
face au vent, mais cette fois ci sur la partie gauche du terrain.

capotage d'un avion de chasse Nieuport 29
Les aérodromes disposent parfois
d'équipements permettant de faciliter l'approche et l'atterrissage
des appareils : manches à air, T d'atterrissage, balises diverses, lampes obstacles,
projecteurs pour les arrivées de nuit... Les terrains sont souvent marqués en
leur centre par un cercle à l'intérieur duquel est noté le nom de l'aérodrome,
visible du ciel.
Diverses installations facilitent la navigation
des pilotes accomplissant des trajets relativement importants dans le ciel de
la métropole : phares maritimes, phares aériens à occultations, feux de jalonnement
au néon... La France compte également en 1930 sept stations de radiogoniométrie,
respectivement situées à Valenciennes, Le Bourget, Strasbourg, Toulouse, Marignane,
Perpignan et Bastia. Des stations de TSF, installées dans près
d'une vingtaine d'aérodromes, permettent aux pilotes de se faire reconnaître
et d'annoncer leur passage ou leur arrivée.

Les aviateurs naviguent généralement à
vue, en s'aidant du compas magnétique et du radiogoniomètre. Ils ne sont à l'époque
pas tenus de se déplacer à l'intérieur de couloirs stricts supervisés par des
contrôleurs aériens : certaines zones sont cependant interdites aux civils,
situées essentiellement à proximité de la frontière Nord-Est et des ports militaires.
| La route recommandée
à l'époque pour accomplir le trajet Paris-Marseille,
par beau temps, est la suivante :
Paris
- Montereau - Sens - Joigny - Auxerre - Avallon - Saulieu
- Chalon-sur-Saône - Mâcon - Belleville - Lyon
(escale) - Crest - Orgon - Salon - Marseille
Par
mauvais temps, il est préférable de suivre le chemin
suivant :
Paris
- Melun - Fontainebleau - Montargis - Briare - Cosne - La
Charité sur Loire - Nevers - Decize - Paray-le-Mosnial -
Beaujeu - Belleville - Lyon (escale) -
Saint-Rambert d'Albon - Montélimar - Orange - Avignon -
Salon - Marseille
La meilleure
route conduisant de Bordeaux à Marseille passe quand à elle
par :
Bordeaux
- Langon - Sainte-Bazeille - Tonneins - Agen - Moissac -
Toulouse (escale) - Castelnaudary - Caracassonne
- Narbonne - Béziers - Montpellier - Arles - Salon - Marseille
|
|
|